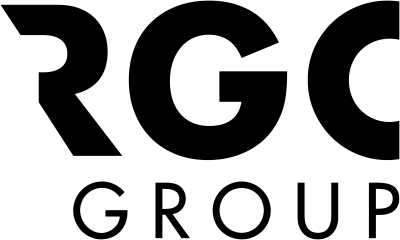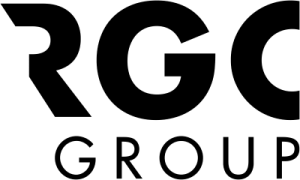On n’y va plus pour se régaler, mais y vivre une expérience !
On y vient pour voir et être vu. Ici, tout est pensé comme une « expérience à vivre » : et tant pis si on ne garde aucun souvenir de son assiette. C’est spectaculinaire !
Le chef Jean Imbert vient de décrocher une étoile au Plaza Athénée. Pourtant, l’arrivée inattendue de « l’ami des stars » dans les cuisines du palace, pour prendre la suite d’Alain Ducasse, avait animé moult débats sur sa légitimité.
Mais le quadra a compris depuis quelque temps déjà qu’il faut aujourd’hui plus que l’assiette pour attirer la clientèle. Résultat : c’est moins la qualité de sa langouste Bellevue avec ses médaillons en gelée qui a été remarquée qu’un décorum digne d’une scène de théâtre. « En quelques mois, le Plaza est devenu une salle de spectacle, avec stuc et dorures, table centrale qui se déplie à l’infini et gerbes de fleurs à foison », sourit Pierre-Yves Chupin, du guide Lebey.
Même amusement du critique gastronomique Stéphane DurandSouffiand : « Vers 22 heures, une voix de stentor accompagnée d’un grelot annonce : « Mesdames et messieurs, la pâtisserie », un rideau se lève et découvre l’équipe du sucré en plein ouvrage. C’est « Au théâtre ce soir » ressuscité ». Restaurant ou divertissement ? Probablement les deux. Et cette mutation du paysage gastronomique s’observe dans tout le secteur, fragilisé depuis la pandémie et ses confinements successifs. Exit le restaurant avec pour seul attrait la quête de saveurs, place à des « expériences », des « lieux » où et décor et l’ambiance importent autant que les plats servis.
Le pouvoir n’est plus aux chefs, tout à leurs fourneaux, ni même aux restaurateurs, qui gèrent les établissements, mais aux entrepreneurs, ces patrons habiles pour multiplier les « marques ». Et dans cette évolution de l’offre, quelques figures se distinguent : Tigrane Seydoux et Victor Lugger, deux anciens de HEC à l’origine du groupe de restas italiens Big Mamma (1500 salariés), ou Laurent de Gourcuff et Benjamin Patou, deux anciens propriétaires de boîtes de nuit reconvertis dans la restauration huppée avec leurs groupes respectifs, Paris Society (2 200 salariés) et Marna Group (1100 salariés).
Ces deux derniers ont la même ambition : rafler les meilleurs lieux. Pour ensuite tout miser sur la décoration, le souci du détail (du cendrier à la tenue des serveurs), avant même de penser aux repas. En somme, le modèle rodé par la famille Costes (Café Marly, Café Beaubourg, Georges, Hôtel Costes…), qui déjà faisait appel à Philippe Starck pour la déco, à Stéphane Pompougnac pour la bande-son, et à de jolies filles en salle, en proposant surtout une cuisine d’assemblage.
En digne héritier, Benjamin Patou provoque : « On ne va plus au restaurant pour manger ! ». Pour lui, avec la multiplication des services de livraison, il faut aujourd’hui une proposition plus forte pour faire sortir les gens de chez eux : « Mes concurrents, ce sont Netflix, le PSG et les cinémas Gaumont ! ». Benjamin Patou investit particulièrement les lieux historiques et patrimoniaux, comme le Bœuf sur le Toit, où le décorateur Alexis Mabille réinvente ce qu’avait créé Cocteau il y a cent ans, ou l’ancienne salle de ventes Drouot, avenue Montaigne, reconvertie en Manko, un restaurant-cabaret péruvien dont la carte est signée par le chef Gaston Acurio et le show par… Garou.
De son côté, Laurent de Gourcuff préfère les belles (et grandes) terrasses. Si bien qu’on peut presque admirer la tour Eiffel sous toutes les faces en allant d’un de ses restaus à l’autre. « Notre métier est devenu de plus en plus saisonnier : du 1er mai au 15 septembre, tout le monde veut être dehors », assène-t-il. Et l’homme a manifestement un don pour mettre la main sur les prestigieuses concessions de la Ville de Paris (le Palais de Chaillot avec Girafe, le Palais Garnier avec CoCo, le Palais de Tokyo avec Monsieur Bleu, la Cité de l’Architecture avec La Suite Girafe).
Dernièrement, c’est l’attribution du Laurent, luxueux pavillon des Jardins des Champs-Élysées, qui a été sujette à caution. Laurent de Gourcuff (associé au chef Mathieu Pacaud sur ce projet) a remporté la concession au nez du groupe Partouche – qui l’exploitait depuis 2012 – et à la barbe de Lionel Roques, patron du groupe d’événementiel Franco American Image. « Tout a été fait pour favoriser Paris Society, déplore ce dernier. Je me doutais que j’entrais dans la mare aux requins, mais je ne pensais pas [que c’était] à ce point… J’en veux à la mairie de Paris, qui attribue ses concessions à la faveur d’un réseau d’influence, pas à la qualité d’un dossier ». Dans les documents d’attribution, que nous avons pu consulter, plus que le projet architectural et paysager, promu par la mairie comme critère clé, c’est véritablement le montant du loyer qui a fait la différence : Paris Society versera 10 % du chiffre d’affaires (anticipé à 12 millions d’euros par an), avec un minimum garanti de 900 000 euros.
Interrogé, Laurent de Gourcuff tempère, assurant n’avoir pas travaillé sur le dossier du Laurent et que ses autres adresses parlent pour lui. « Au début, avec Monsieur Bleu, j’envisageais 4 millions d’euros de chiffre d’affaires. La première année, on a fait 11 millions ! Avec une redevance à 10 %, ça plaît au propriétaire, rapporte celui qu’on surnomme désormais « Monsieur 10 % ». Comme aucun de mes restas n’est déficitaire, aujourd’hui je garantis systématiquement 800 000 euros, comme ça, je suis sûr de mon coup ». L’argent va à l’argent. Au point qu’aujourd’hui le Monopoly des meilleurs spots de Paris est terminé. Alors, Laurent de Gourcuff et Benjamin Fatou commencent à exporter leurs « marques » vers les lieux de villégiature de leur clientèle : Megève, Courchevel, Val-d’Isère, Saint-Tropez et Saint-Barth. Mais aussi à l’étranger : Londres et Dubai pour Laurent de Gourcuff, Athènes et Doha pour Benjamin Fatou. D’autres projets sont à l’étude à Milan, New York, Miami … « Ils vont vite, trop vite peut-être, note Bernard Bouthoul, président du cabinet de conseil Gira. Ils multiplient les ouvertures, et donc les prêts, et cela peut se révéler économiquement fragile ».
Nicolas Chatenier, consultant culinaire et responsable en France des « 50 Best », le classement annuel des meilleurs restaurants dans le monde, nuance : « Si Gourcuff et Patou accélèrent ce développement, c’est que ce modèle fonctionne. Ce sont eux qui aujourd’hui font la tendance, les prix aussi. Les meilleurs endroits tombent dans leur escarcelle et cela réduit la zone d’expression de la gastronomie ». Car si ces adresses ne désemplissent pas, elles accueillent surtout une clientèle aisée à la recherche d’un cadre élégant, où l’on peut voir et être vu – sans se poser trop de questions sur la nourriture.
Soyons clairs : c’est bon, réconfortant, mais jamais mémorable. Une cuisine très normée, avec des plats bien exécutés, mais sans créativité particulière. Ainsi, sur tous les menus, s’imposent en standards le carpaccio, le tataki, le ceviche, le poulpe grillé et, ces derniers temps, le vitello tonnato. On pourrait lire les cartes de ces endroits les yeux fermés. Critique rejetée par Victor Lugger de Big Mamma : « Notre métier n’est pas de nourrir les gens, mais de donner une expérience à vivre. En France, il y a ce snobisme infernal qui consiste à penser que seule l’assiette a de l’importance. Sauf qu’un restaurant, c’est bien plus que ça ».
Quand, dans un étoilé, le serveur détaille chaque fournisseur, chaque produit, cela fait partie du narratif. C’est la même chose quand Shake Shack [chaîne américaine de burgers, NDLR] soigne sa musique. Il ne faut pas s’excuser de faire attention aux détails » ! Nicolas Chatenier s’inquiète pourtant d’une « frontière moins claire qu’avant : quand on va chercher Jean Imbert, on flirte avec les lignes, on choisit un acteur de la gastronomie mais on lui fait faire quelque chose qui n’en est pas… ». Benjamin Fatou jure mettre la gastronomie « au cœur de son projet », même s’il concède que « la compétition est telle qu’il faut cocher toutes les cases, ambiance et divertissement compris ». L’assiette est un élément du concept, de la « marque », mais il n’est plus le seul. Un client nous résume avec justesse cette nouvelle équation : « C’est pas bon, c’est pas mauvais ; en fait, c’est pas le sujet ».
L’OBS, Christel Brion, Boris Manenti, 21 avril 2022